La face cachée de votre pharmacie
Contre la rhinite, le spray nasal s’impose comme le dispositif le plus efficace et le plus facile à se procurer, car en vente libre.
Utilisé pour décongestionner le nez, ce médicament est un basique de l’automédication. En cas de surdosage ou d’accoutumance, il ne fera pourtant que prolonger la rhinite.
Pour aller directement au chapitre 1, cliquez sur le lien ci-dessous :
Le paracétamol est l’un des médicaments les plus utilisés au monde. Mal de tête, hop, un cachet. Poussée de fièvre, hop, un cachet. Règles douloureuses, hop, un cachet...
L’antidouleur réputé non dangereux et non toxique s’obtient très facilement. Son abus peut pourtant endommager le foie. Dans les cas les plus graves, de façon irréversible.
Aller directement au chapitre 2
La pilule reste aujourd’hui la première méthode de contraception. Mais elle n’est pas sans effets indésirables, ni sans risques. Ils sont cependant loin de dépasser ses avantages et son efficacité.
Aller directement au chapitre 3
Qui n’a pas d’ibuprofène dans sa pharmacie? C’est l’un des médicaments les plus utilisés en automédication comme antalgique (contre la douleur) ou comme antipyrétique (contre la fièvre).
Complications pulmonaires, infections sévères, troubles digestifs… Les effets indésirables de cet anti-inflammatoire accessible sans ordonnance imposent la prudence.
Aller directement au chapitre 4
Codéine, tramadol, oxycodone… sont tous des opioïdes hautement addictifs. Les prescriptions de ces antidouleurs ne cessent pourtant d’augmenter en Belgique.
Si les chiffres de consommation belges n’atteignent pas ceux des États-Unis, en raison d’un accès contrôlé à ces médicaments et d’une interdiction de la publicité médicale, ils sont toutefois en forte hausse.
Aller directement au chapitre 5
Chapitre 1
Accro au… spray nasal : les dangers insoupçonnés d’un médicament trop utilisé

Utilisé pour décongestionner le nez, le médicament est un basique de l’automédication. En cas de surdosage ou d’accoutumance, il ne fera pourtant que prolonger la rhinite.
L’addiction aux médicaments ne concerne pas que les analgésiques ou les somnifères. Certains mécanismes de dépendance sont plus insidieux. Ainsi du spray nasal. Quoi de plus courant pourtant que d’avoir le nez bouché, symptôme annonciateur d’un refroidissement ou d’une allergie.
L’obstruction nasale est d’ailleurs le désagrément le plus fréquemment rapporté en cas de rhinosinusite aiguë ou chronique. Lors d’une maladie des voies respiratoires supérieures, la première réaction de l’organisme est d’augmenter les sécrétions. L’un des rôles de la muqueuse nasale est en effet de bloquer les intrus pour les empêcher de pénétrer dans les voies respiratoires. Si un rhume ou une allergie se déclare, la muqueuse se mettra à gonfler et à produire davantage de mucus afin d’évacuer le virus, les bactéries ou les allergènes.
Lorsque l’inflammation et le gonflement de la muqueuse durent plus de trois mois, on parle de rhinite chronique. Il s’agit d’une extension de la rhinite simple, causée par une inflammation, une infection virale ou, plus rarement, une autre affection.
Un usage prolongé est susceptible de provoquer une congestion de rebond.
Un cercle vicieux
Quelle qu’en soit la cause, avoir le nez qui coule ou bouché provoque un inconfort certain, surtout lorsque d’autres symptômes sont associés – un vilain mal de tête, la gorge qui gratte, des éternuements à répétition ou une conjonctivite.
Contre la rhinite, le spray nasal s’impose comme le dispositif le plus efficace et le plus facile à se procurer, car en vente libre. La plupart de ces médicaments contiennent de la xylométazoline ou de la tramazoline, deux vasoconstricteurs que l’on retrouve, par exemple, dans l’Otrivine, le Nesivine, le Xylomaris ou encore le Rhinospray. Le vasoconstricteur décongestionnant peut être utilisé seul ou en association avec un antiseptique ou un anti-inflammatoire.
Une fois injecté dans les narines, le produit agit sur les membranes de la muqueuse qui recouvrent la cavité nasale. Celles-ci contiennent des vaisseaux approvisionnés en sang que le médicament «resserre», ce qui a pour effet de dégonfler les muqueuses et de permettre à l’air de circuler à nouveau.
L’usage de ces sprays nasaux ne doit pas s’étirer au-delà des cinq à sept jours car nos muqueuses peuvent très vite s’habituer à recevoir leur dose quotidienne de décongestionnant. Si bien qu’en cas d’arrêt ou de diminution du nombre de pulvérisations, le gonflement reprendra de plus belle. C’est ce qu’on appelle une congestion de rebond ou rhinite médicamenteuse.
Les effets indésirables du spray nasal
«Cette remarquable efficacité [des vasoconstricteurs, VC] sur l’obstruction nasale est à l’origine de renouvellements inadaptés de prescriptions, d’une auto-médication abusive et ce, d’autant que les VC sont en vente libre, met en garde un groupe de chercheurs dans une mise au point sur l’effet rebond en pratique clinique dans les Annales françaises d’oto-rhino-laryngologie et de pathologie cervico-faciale (2013). Ce mésusage dans l’utilisation des VC peut être majoré par le fait que certains d’entre eux font partie d’associations médicamenteuses avec d’autres principes actifs comme la cétirizine (NDLR: un antihistaminique), le paracétamol ou l’ibuprofène, dans des spécialités par voie orale accessibles sans prescription médicale.»
Les effets indésirables liés au surdosage ne sont pas sans gravité. Les usagers au doigt collé sur le pulvérisateur risquent de développer une rhinite chronique ou un dessèchement de la muqueuse nasale (qui ne pourra alors plus jouer correctement son rôle de barrière protectrice) avec formation de croûtes et saignements du nez. Ils risquent aussi de retomber malade plus rapidement.
Sevrage radical ou en douceur
Le Centre belge d’information pharmacothérapeutique (CBIP) invite, lui aussi, à consommer les vasoconstricteurs avec modération, surtout pour les personnes à risque que sont les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et celles souffrant de problèmes cardiovasculaires. Dans la liste des effets indésirables potentiels, l’organisme mentionne des cas d’hypertension et de tachycardie, éventuellement associés à une angine de poitrine, un accident vasculaire cérébral et une ischémie myocardique. Mais aussi des effets neurologiques importants tels qu’une agitation, des convulsions, des hallucinations et de l’anxiété.
Plusieurs stratégies peuvent être adoptées pour sortir du cercle vicieux de l’usage abusif du spray nasal. La méthode la plus évidente consiste à stopper purement et simplement la prise du médicament. Si nécessaire, des corticoïdes en pulvérisateur nasal peuvent être utilisés. Le patient devra s’armer de patience car il lui faudra rester avec le nez bouché quelques jours avant d’observer un dégagement progressif des voies nasales. Plus longue mais moins radicale, une autre technique consiste à commencer le sevrage par une des deux narines, avant de s’attaquer à l’autre. Dernière astuce: remplacer les pulvé- risations par un rinçage du nez à base de solution saline.
Chapitre 2
Paracétamol: les risques de dommages irréversibles pour le foie

L’antidouleur réputé non dangereux et non toxique s’obtient très facilement. Son abus peut pourtant endommager le foie. Dans les cas les plus graves, de façon irréversible.
Il se glisse partout: dans l’armoire à pharmacie, la trousse de voyage, le sac à main, le tiroir du bureau. Disponible sans ordonnance, le paracétamol est l’un des médicaments les plus utilisés au monde. Mal de tête, hop, un cachet. Poussée de fièvre, hop, un cachet. Règles douloureuses, hop, un cachet. Mal de dent, hop, un cachet… Très vite, c’est toute la boîte qui y passe.
Une étude de Sciensano, publiée en 2018, confirme l’énorme consommation d’analgésiques des Belges. Ainsi, 36,8% des médicaments non remboursés commandés en pharmacie agissent sur le système nerveux central. Les deux principaux sont l’acétaminophène, l’autre nom du paracétamol, et les calmants ou tranquillisants que sont les benzo- diazépines. Sur dix analgésiques consommés, six sont des analgésiques dits «ordinaires», presque exclusivement des cachets de Dafalgan, Perdolan et autres déclinaisons du paracétamol. Les quatre autres sont des opioïdes, comme le tramadol, l’oxycodone ou le fentanyl. Clairement, le paracétamol présente d’indéniables atouts: efficace, disponible sous plusieurs formes, il combat tant la douleur que la fièvre et convient aux enfants et aux femmes enceintes.
L’excès de paracétamol peut entraîner une nécrose du foie nécessitant une transplantation.
Pour son enquête, Sciensano a demandé aux participants à quand remontait leur dernière prise d’analgésiques. Pour 6,5%, la réponse fut moins de 24 heures. Sur le long terme aussi, la consommation décolle: le pourcentage de personnes ayant pris un analgésique ordinaire au cours de la journée écoulée est resté relativement stable entre 2004 et 2013 mais a augmenté de manière significative entre 2013 et 2018, passant de 3,1% à 4,5%. Chez qui? Les femmes en consomment le plus. Principalement le groupe des 35-54 ans (5,5% en avaient consommé au cours des dernières 24 heures) mais surtout les plus de 75 ans (10%). Les différences sont aussi socio-économiques: les utilisateurs, tous genres confondus, «plus éduqués» en consomment moins.
Un allié qui peut vous tuer
Si le paracétamol est de loin l’antidouleur le plus connu du grand public, ses effets sur notre organisme en cas de surconsommation le sont nettement moins. Depuis vingt ans pourtant, les médecins et les chercheurs ne cessent d’alerter sur les ravages de la consommation excessive de ces cachets largement perçus comme inoffensifs, ou en tout cas moins néfastes que les anti-inflammatoires, alors qu’elle représentait déjà la première cause d’insuffisance hépatique observée dans les centres d’urgence européens et américains, comme le mentionne une étude de grande envergure parue, en 2005, dans le magazine Hepatology.
En Belgique, le paracétamol est la première cause d’hospitalisation pour les cas d’hépatite médicamenteuse. En 2022, 2 640 appels passés au centre antipoison, sur un total de 61 699, concernaient le paracétamol, soit une augmentation d’un tiers en cinq ans.
Comme il est accessible sans ordonnance, le patient ne reçoit pas forcément de mise en garde sur sa toxicité.
Dans les cas les plus graves, l’excès de paracétamol peut entraîner une nécrose du foie nécessitant une transplantation. En Angleterre, où il est encore plus facile de s’en procurer qu’en Belgique, c’est la première cause de transplantation hépatique d’origine médicamenteuse. Chez nous, ça reste actuellement la stéatohépatite non alcoolique (maladie du foie gras, Nash) et les hépatopathies alcooliques. Les transplantations pour cause d’hépatite fulminante au paracétamol sont nettement plus rares, de l’ordre de quelques cas par an, mais elles existent.
Ce qui inquiète aussi certains médecins, c’est qu’émergent des cas d’hépatotoxicité sévère alors que les patients n’ont consommé des cachets qu’à dose thérapeutique, relevait déjà, en 2007, la Revue médicale suisse dans une analyse sur les populations à risque. Bien sûr, le potentiel hépatotoxique du paracétamol peut varier d’un individu à l’autre et dépend fortement de la présence ou non de facteurs de risque. Sont considérés comme tels le jeûne ou la malnutrition, la consommation régulière d’alcool, l’interaction avec d’autres médicaments, comme des antiépileptiques, par exemple, ainsi que d’autres facteurs génétiques. Les personnes dont le foie est déjà fragilisé par des pathologies aiguës ou chroniques sont plus à risque également.
Chapitre 3
Baisse de libido, dépression, cancers… La face cachée de la pilule contraceptive
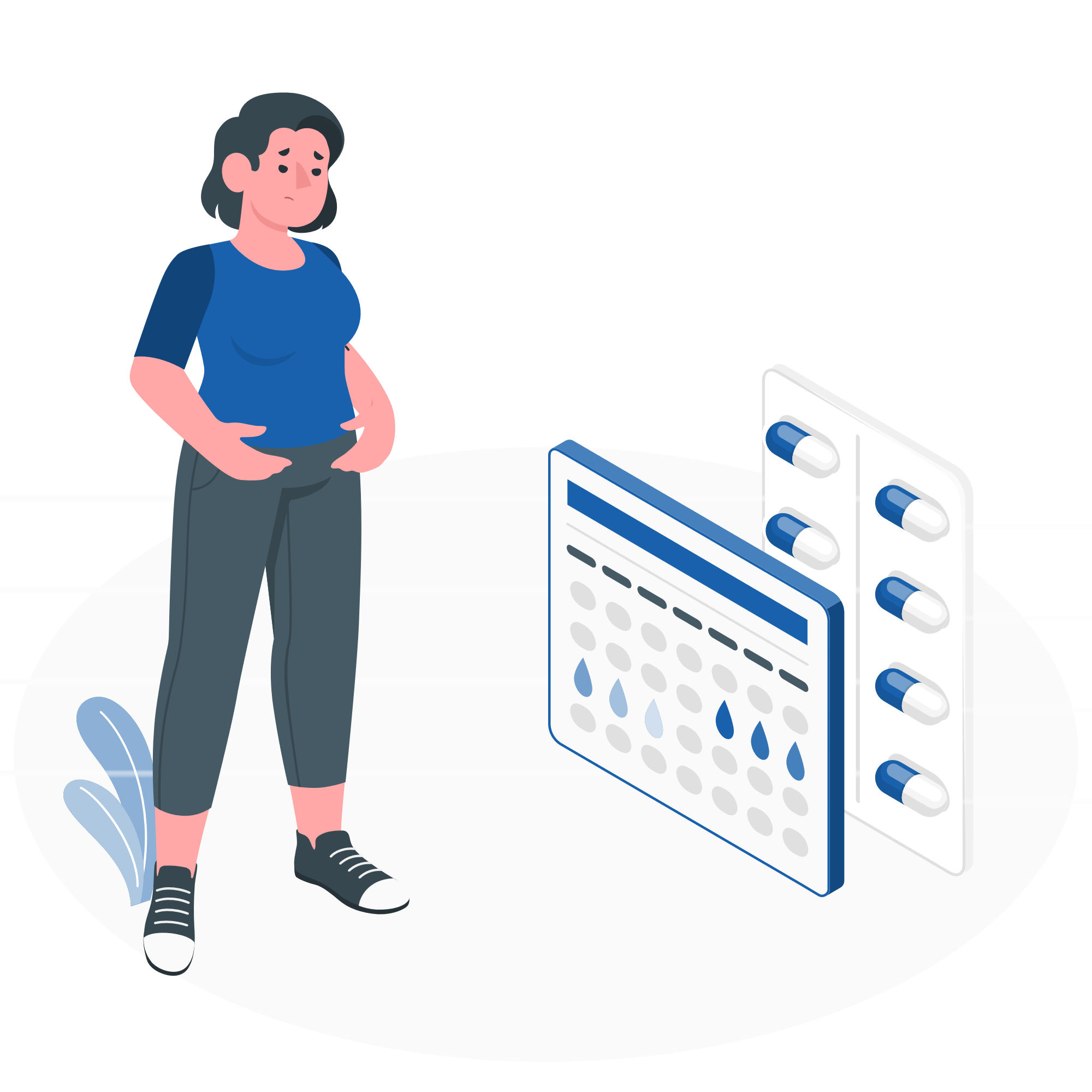
Ce moyen de contraception n’est pas sans effets indésirables, ni sans risques. Ils sont cependant loin de dépasser ses avantages et son efficacité.
C’est un petit comprimé qui fait beaucoup parler de lui, entre jeunes filles et jeunes femmes, qu’elles aient 17, 20 ou 35 ans: la pilule. Et pour cause: la norme contraceptive n’a guère changé et demeure relativement uniforme. Elles commencent leur vie sexuelle avec le préservatif, puis prennent la pilule lorsqu’elles entament une relation stable et se font poser un stérilet après avoir eu des enfants. On estime, d’après les données de l’institut de santé publique Sciensano, que plus de la moitié des femmes entre 16 et 55 ans recourent à la pilule contraceptive (un taux parmi les plus élevés d’Europe). La pilule reste aujourd’hui la première méthode de contraception. Cependant, son utilisation baisse petit à petit. Selon une étude menée par la mutualité Solidaris, en 2017, une femme sur deux déclare avoir changé de type de contraception, contre un tiers en 2010.
Ce recul est toutefois partiellement compensé par l’adoption d’autres moyens contraceptifs. Les femmes se sont ainsi portées vers le stérilet, l’anneau vaginal et l’implant. Mais dans ce constat, le point saillant est la hausse, parmi les freins contraceptifs, des effets secondaires (+ 24% par rapport 2010) et de la nocivité pour la santé (+ 16%).
Prescrite pour prévenir un événement (une grossesse) qui n’est pas une maladie, à des femmes en bonne santé (en l’absence d’une pathologie, évidemment), la pilule n’en reste pas moins un «médicament, avec ce que cela comporte d’effets bénéfiques, mais aussi d’éventuels effets indésirables ou de risques». Ballonnements, douleurs aux seins et à la tête, troubles de l’humeur, nausées et saignements irréguliers font partir des désagréments les plus courants. Certains sont passagers et plutôt bénins. Par exemple, la mastodynie (tensions dans les seins), un effet indésirable fréquent, apparaît souvent au cours du premier cycle et disparaît généralement au deuxième, voire au troisième mois. Ou les nausées qui, elles aussi, se dissipent à court terme. Ou encore le mal de tête, qui se traite souvent en réduisant la dose d’œstrogènes ou en passant à un autre type de pilule – la microprogestative a un impact positif sur la migraine.
D’autres, pour l’heure, ne font pas l’objet d’un consensus. La pilule nuit-elle à la libido? Entraîne-t-elle un risque dépressif?
Selon une trentaine – donc peu – d’enquêtes publiées sur le sujet ces vingt dernières années, environ 15% des femmes sous contraception hormonale rapportent une baisse de leur désir. Les scientifiques, eux, s’opposent et les études qu’ils produisent sont contradictoires. En réalité, les mécanismes biologiques pouvant expliquer ce lien ne sont pas clairs. L’une des pistes résulterait de ce que la pilule réduit la fabrication de testostérone par les ovaires et augmente une protéine, la SHBG (sex hormone binding globulin), qui capte la testostérone et la rend inactive. Or, cette hormone masculine influe sur la libido et le désir sexuel. Une certitude qui, elle, fait consensus parmi les praticiens: il peut y avoir une baisse d’élan sexuel, mais elle dépend du type de pilule, de la patiente et adopte des degrés divers. Autrement dit, chaque patiente réagit différemment et ce manque de désir peut découler d’une combinaison de facteurs. Les scientifiques postulent l’existence d’un polymorphisme génétique qui expliquerait que certaines femmes sous pilule voient leur libido décroître et pas d’autres. Ils croient également aux effets non anatomiques, comme le stress, l’état de la relation, le fait d’avoir un partenaire régulier – un facteur de risque de baisse de libido tout aussi puissant, d’après les enquêtes.
Indice de Pearl
Cet indice statistique est utilisé dans les essais cliniques pour mesurer l’efficacité des méthodes de contraception, «en théorie», c’est-à-dire utilisées de façon optimale. Dès lors, les autorités sanitaires calculent un taux d’efficacité qui tient compte des aléas de leur utilisation et de leur interaction avec d’autres médicaments. L’implant sous-cutané présente un taux d’«efficacité pratique» de 99,95%, le stérilet hormonal de 99,8%, le stérilet en cuivre de 99,2%, la pilule de 92%, le préservatif de 85%.
Plus de la moitié des femmes entre 16 et 55 ans recourent à la pilule contraceptive
Quel impact de la pilule contraceptive en matière de dépression?
Quant au risque dépressif, une étude suédoise, publiée en juin dernier dans la revue Epidemiology and Psychiatric Sciences, établit une corrélation entre la dépression et la prise de la pilule œstroprogestative (aussi appelée «pilule combinée»). Les chercheurs du département d’immunologie, de génétique et de pathologie de l’université d’Uppsala ont étudié les dossiers médicaux de près de 265 000 femmes britanniques, de la naissance à la ménopause, issues de la base de données UK Biobank. Ils observent deux choses: tout d’abord, 73% de risques supplémentaires de souffrir de symptômes dépressifs dans les deux premières années après le début de la contraception, par rapport aux femmes qui ne la prennent pas. Chez celles qui ont commencé à l’adolescence, l’incidence grimpe à 130%. Cette étude suédoise s’ajoute aux recherches antérieures ayant déjà soulevé un lien entre les contraceptifs hormonaux et la dépression. Des travaux danois, publiés en 2016 dans la revue Jama Psychiatry et portant sur plus d’un million de femmes de 15 à 34 ans, notaient que les femmes ayant recourt à la contraception hormonale étaient plus susceptibles de suivre un traitement par antidépresseurs et d’être diagnostiquées dépressives.
Les jeunes femmes seraient ainsi plus exposées. Les chercheurs attribuent cela aux changements hormonaux provoqués par la puberté, alors que leur cerveau n’a pas terminé sa maturation. A quoi peuvent se joindre un stress lié à la vie étudiante, la précarité, la consommation d’alcool et de drogues, etc.: un cocktail qui affecte davantage leur santé mentale. Bien entendu, cela ne concerne pas toutes les femmes. La contraception orale augmente un risque probablement présent chez des patientes déjà vulnérables. L’histoire familiale joue, elle aussi, sur cette incidence.
Deux types de pilule
La pilule combinée ou œstroprogestative
Composée d’un progestatif et d’un œstrogène, deux composants hormonaux visant à bloquer l’ovulation et l’implantation de l’ovule, ce contraceptif, le plus prescrit, a évolué, passant par quatre «générations»: plus une «génération» est avancée dans le temps, plus la pilule sera faiblement dosée en hormones de synthèse.
La micropilule ou microprogestative
Il s’agit d’une pilule microdosée ne contenant qu’un progestatif de synthèse. Elle se prend à heures fixes sans interruption. Elle serait de plus en plus utilisée.
Les femmes ayant recourt à la contraception hormonale étaient plus susceptibles de suivre un traitement par antidépresseurs et d’être diagnostiquées dépressives.
Troisième à l’échelle mondiale
L’effet de la pilule est enfin, a priori, paradoxal. Le médicament présente des effets secondaires possibles plus graves, en particulier sur le plan vasculaire et veineux (phlébite, accidents vasculaires cérébraux, infarctus…), surtout chez les fumeuses. Le risque de thrombose est multiplié par trois chez une femme sous pilule combinée, soit, en chiffre, trois pour dix mille par an, contre un pour dix mille par an. Pour une femme sous pilule de 3e ou 4e génération, le risque s’élève à cinq pour dix mille par an. En comparaison, la grossesse multiplie ce risque par dix.
La contraception orale, y compris celle ne contenant qu’un progestatif, augmente également légèrement le risque du cancer du sein (par 1,2, un risque qui disparaît après cinq ans d’arrêt), du cancer du col de l’utérus (par 1,5, disparaissant après huit ans d’arrêt) et du cancer du foi (par 2,8). A l’inverse, la pilule combinée diminue durablement le risque d’atteinte d’autres organes. Ainsi, elle confère une importante protection contre le cancer de l’endomètre: cinq années d’utilisation réduisent le risque d’un quart et l’effet se prolonge pendant au moins trente ans après l’arrêt de la pilule. Cet effet protecteur se retrouve dans le cancer de l’ovaire. Une grande étude épidémiologique, menée aux États-Unis, montre qu’une contraception orale durant au moins dix ans fait baisser le risque de cancer de l’ovaire de 40% par rapport à l’absence de contraception orale.
Au regard de ces recherches, d’aucuns se demandent, légitimement, pourquoi les praticiens, conscients des effets indésirables, continuent de prescrire la pilule. C’est simple: à l’instar d’autres médicaments, ses risques d’effets secondaires sont inférieurs à ses bienfaits et à son efficacité. A l’échelle mondiale, la pilule est troisième, derrière la stérilisation (marginale en Belgique) et le stérilet.
Sans hormones
Actuellement, une équipe de chercheurs du KTH Royal Institute of Technology, en Suède, travaille sur le développement d’un gel contraceptif vaginal non hormonal qui épargnerait aux femmes les effets indésirables de la pilule. A la différence des spermicides – qui tuent les spermatozoïdes –, ce gel agirait en épaississant la glaire cervicale, sécrétion produite par les glandes du col de l’utérus et qui fait office de barrière entre le vagin et le col. Cette action empêcherait le passage des spermatozoïdes dans l’utérus. Le gel serait, en outre, applicable en quelques secondes, jusqu’à quelques heures en amont d’un rapport sexuel incluant une pénétration vaginale. Son effet diminue cependant au fil du temps, à mesure que la glaire cervicale est remplacée naturellement. Les tests précliniques, menés sur des brebis, vantent une efficacité de 98%, dont les résultats ont été publiés dans la revue Science Translational Medicine, le 30 novembre 2022. Reste à l’essayer sur l’humain… d’ici à quelques années.
Chapitre 4
L’ibuprofène, une molécule loin d’être sans danger

Complications pulmonaires, infections sévères, troubles digestifs… Les effets indésirables de cet anti-inflammatoire accessible sans ordonnance imposent la prudence.
Qui n’a pas d’ibuprofène dans sa pharmacie? Figurant parmi les AINS (anti- inflammatoires non stéroïdiens), c’est l’un des médicaments les plus utilisés en automédication comme antalgique (contre la douleur) ou comme antipyrétique (contre la fièvre). Un geste potentiellement dangereux dans certains cas. En 2016, déjà, l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) alertait sur les risques de ce produit. Comme ses homologues européens, elle retapait sur le clou, en 2020, puis, à nouveau, en 2023, en appelant à la prudence: «Le prendre à la plus faible dose efficace pendant la durée la plus courte, c’est-à-dire pas plus de trois jours en cas de fièvre et de cinq jours en cas de douleur.» En effet, cette molécule, «très utile à des pathologies adaptées», est loin d’être sans danger. La liste des effets secondaires n’a d’ailleurs cessé de s’allonger ces dernières années.
Pris durant une courte période, en cas d’infection (rhino-pharyngite, angine, otite…), l’ibuprofène réduit l’action du système immunitaire et risque alors d’aggraver l’état du malade. Comment un médicament qui soulage la douleur d’un côté peut-il exacerber une infection de l’autre? Puisque cet anti-inflammatoire masque les symptômes et leur évolution, en faisant diminuer la fièvre, il conduit à reporter la prise en charge de l’infection qui, elle, continue de se développer. Les chercheurs pensent d’ailleurs que la substance retarde l’arrivée des cellules du système immunitaire au niveau des sites infectés.
7% des futures mères absorbent de l’ibuprofène dangereux pour le fœtus et 30% l’ignorent, selon une enquête des Mutualités libres. Déjà «formellement contre-indiqué» à partir du sixième mois de la grossesse, car susceptible de causer des atteintes cardiaques et rénales potentiellement fatales chez le fœtus ou le nouveau-né, l’anti-inflammatoire serait également nocif dès le premier trimestre pour le futur appareil génital et reproducteur de l’enfant de sexe masculin. L’ibuprofène ne doit pas être confondu avec la cortisone, également un anti-inflammatoire mais plus puissant. Il est employé dans les traitements de certaines formes de rhumatisme et d’arthrose, des tendinites, des lombalgies, des sciatiques ou encore des règles douloureuses.
Inflammation bloquée
Ce phénomène est intrinsèquement lié à son mode d’action. Contrairement au paracétamol, l’ibuprofène est un anti-inflammatoire non stéroïdien. Ce qui signifie qu’il agit en bloquant l’inflammation. Cette réaction du système immunitaire indispensable pour combattre virus, bactéries ou champignons peut provoquer des douleurs. Par exemple, le mal dû à un abcès dentaire sera bien atténué par l’ibuprofène, mais, dans le même temps, les micro-organismes pathogènes auront tout le loisir de se multiplier, en l’absence de réaction inflammatoire.
Ce n’est pas la seule explication. Certains AINS auraient une action directe sur les germes à l’origine de l’infection. Ainsi des études menées chez l’animal ont montré que l’ibuprofène favorisait la croissance de certaines bactéries, même en présence d’antibiotiques. L’antalgique, selon les chercheurs, modifierait une protéine, la vimentine, qui intervient dans la prolifération de ces bactéries. Un phénomène qui serait spécifique aux infections à streptocoques et à pneumocoques.
L’anti-inflammatoire expose également à des troubles digestifs. Ici encore, ils sont le résultat de son mécanisme de lutte contre la douleur. L’ibuprofène agit en inhibant une enzyme appelée cyclooxygénase (COX) impliquée dans certains rhumatismes, mais cette enzyme est aussi garante de l’intégrité de la muqueuse de l’estomac. Cela devient alors un cercle vicieux: en augmentant l’acidité, il favorise les maux de ventre, allant du simple inconfort jusqu’à l’ulcère. Enfin, pris pendant de longues périodes, les anti-inflammatoires augmentent également les risques d’insuffisance rénale.
La fin du libre accès?
De tout cela, concluent les agences des médicaments européennes, le paracétamol est à privilégier en première intention, car la liste des effets indésirables des AINS ne s’arrête pas là. Assez rapidement, l’ibuprofène a été soupçonné d’accroître, certes légèrement, le risque de problèmes cardiovasculaires, comme l’infarctus et l’accident vasculaire cérébral, à des doses élevées (au moins 2 400 mg, soit la dose maximale autorisée, double de la dose habituellement utilisée).
Pour limiter les risques, l’Agence française de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a mis fin au libre accès en pharmacie de ces familles de médicaments. Depuis janvier 2020, ce sont les pharmaciens, au comptoir, qui délivrent ces produits aux personnes souhaitant les acheter sans ordonnance, l’objectif étant de débanaliser leur utilisation. Le paracétamol et l’aspirine ont subi le même sort.
En Belgique, des experts, à l’instar de Jean-Michel Dogné, directeur du département de pharmacie à l’UNamur et membre de l’Agence européenne des médicaments (EMA), demandent que la même mesure soit appliquée dans notre pays, estimant que les risques, lors d’une utilisation inadéquate, demeurent sous-estimés, particulièrement parmi le grand public. En vain.
Chapitre 5
L’inquiétant succès du tramadol: « Je ressentais un apaisement, un flottement »

Codéine, tramadol, oxycodone… sont tous des opioïdes hautement addictifs. Les prescriptions de ces antidouleurs ne cessent pourtant d’augmenter en Belgique.
Pour ce quadragénaire, la rencontre avec les médicaments opiacés eut lieu il y a cinq ans, après une rupture du tendon d’Achille. Il sort de l’hôpital avec deux boîtes de tramadol, un dérivé synthétique de l’opium, commercialisé sous plus de vingt noms différents. «J’avais mal, le chirurgien m’a prescrit du Contramal, se souvient Sébastien. Tout de suite, j’ai accroché. La douleur était nettement diminuée mais je ressentais aussi un apaisement, un flottement.» Après une semaine, il décide d’arrêter et les boîtes sont restées en excès dans sa pharmacie, favorisant l’automédication. «Si j’avais mal quelque part, ça me faisait du bien. J’en ai pris de façon épisodique, jusqu’à ce que toutes les boîtes soient vides.» Lui qui n’a jamais pris la moindre drogue affirme que «s’il n’avait pas eu une vie équilibrée, une compagne, des enfants, un boulot grisant», il aurait pu «devenir addict, comme dans l’histoire américaine».
L’«histoire américaine», comme l’appelle Sébastien, c’est cette crise des opioïdes qui ravage les Etats-Unis depuis maintenant quinze ans. Avec des chiffres chaque année plus effrayants. En 2023, 120 000 personnes sont mortes d’overdose, dont les deux tiers décimées par des opioïdes (presque essentiellement de palier 3, lire l’encadré), prescrits par des médecins ou acquis sur le marché parallèle.
40%L’augmentation de la consommation de tramadol depuis 2010.
La Belgique est 3e, derrière l’Allemagne et l’Autriche, dans le classement des pays européens dont la consommation journalière d’opioïdes par million d’habitants est la plus élevée, selon l’OMS.
Si les chiffres de consommation belges n’atteignent pas ceux des Etats-Unis, en raison d’un accès contrôlé à ces médicaments et d’une interdiction de la publicité médicale, ils sont toutefois en forte hausse. L’Inami, alerté entre autres par l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS), pointe cinq opioïdes dont l’usage a considérablement augmenté au cours des dix dernières années: le tramadol, l’oxycodone, la tilidine (interdite en Belgique depuis trois ans), les patchs de fentanyl et le piritramide constituent à eux seuls 80% de la consommation d’opioïdes. C’est ainsi que de 638 939 patients consommateurs d’opioïdes en 2006, on est passé à 1 186 943 en 2016, soit 10% de la population. Des chiffres confirmés par Eurotox, l’observatoire socio- épidémique alcool-drogues en Wallonie et à Bruxelles, qui s’appuie sur les données de Pharmanet, plateforme dénombrant les médicaments délivrés en pharmacie (hors codéine): 573 104 patients en 2005 à 1 100 519 en 2021, soit presque un doublement en quinze ans.
Tout en haut de la liste des coupables, le tramadol, l’antalgique le plus prescrit en Belgique (703 502 patients ont reçu une prescription en 2021), soulève le plus d’inquiétude. Il n’est pas le plus puissant mais le risque de dépendance existe, à l’instar de tous les opioïdes, même si elle est plus lente à s’installer. Le tramadol a ceci de particulier qu’il agit à la fois comme un opioïde et un antidépresseur. La molécule opère sur les mêmes récepteurs que la morphine, appelés «les récepteurs opiacés». Il existe donc un risque réel de dépendance et de surdose. Et, contrairement à la codéine et à la morphine, elle possède une deuxième fonction: agir également sur les systèmes de la sérotonine et de la noradrénaline, impliqués dans la gestion des humeurs. L’antidouleur a donc un effet anxiolytique, et augmente ici aussi le risque d’addiction. Ainsi, certains patients continuent d’en consommer pour soulager leur stress et leur anxiété, alors que leur douleur a disparu.
Le tramadol a ceci de particulier qu’il agit à la fois comme un opioïde et un antidépresseur.
Très efficace, le tramadol est aussi l’antalgique opiacé avec le plus d’effets indésirables. Souvent anodins – constipation, nausée, vertige – mais parfois plus graves, comme des troubles du sommeil et un risque élevé d’accidents et de fractures. Lorsqu’il est pris de manière prolongée, une dépendance physique peut s’installer et contribuer à accroître une hyperalgésie, c’est-à-dire une augmentation de la sensibilité à la douleur induite par la prise d’opioïdes. Après avoir développé une tolérance (le corps s’habitue), le patient est contraint d’augmenter les doses pour ressentir les mêmes effets, favorisant ainsi l’accoutumance.
Il s’expose alors à un surdosage, avec un risque de décès par dépression respiratoire. Peu de chiffres sont disponibles en Belgique sur les overdoses par opioïdes. La dernière enquête, menée par de l’institut de santé publique Sciensano, en 2014, comptabilisait 140 overdoses dont une septantaine seraient dues aux opioïdes. Mais ce ne serait là que de la partie émergée de l’iceberg, puisqu’il n’existe aucun registre spécifique. Les chiffres sont donc sous-estimés à cause de la sous-déclaration. Nombre de cas d’overdose sont classés morts naturelles, parce qu’ils ne sont pas toujours bien identifiés par les médecins ou tout simplement non déclarés.
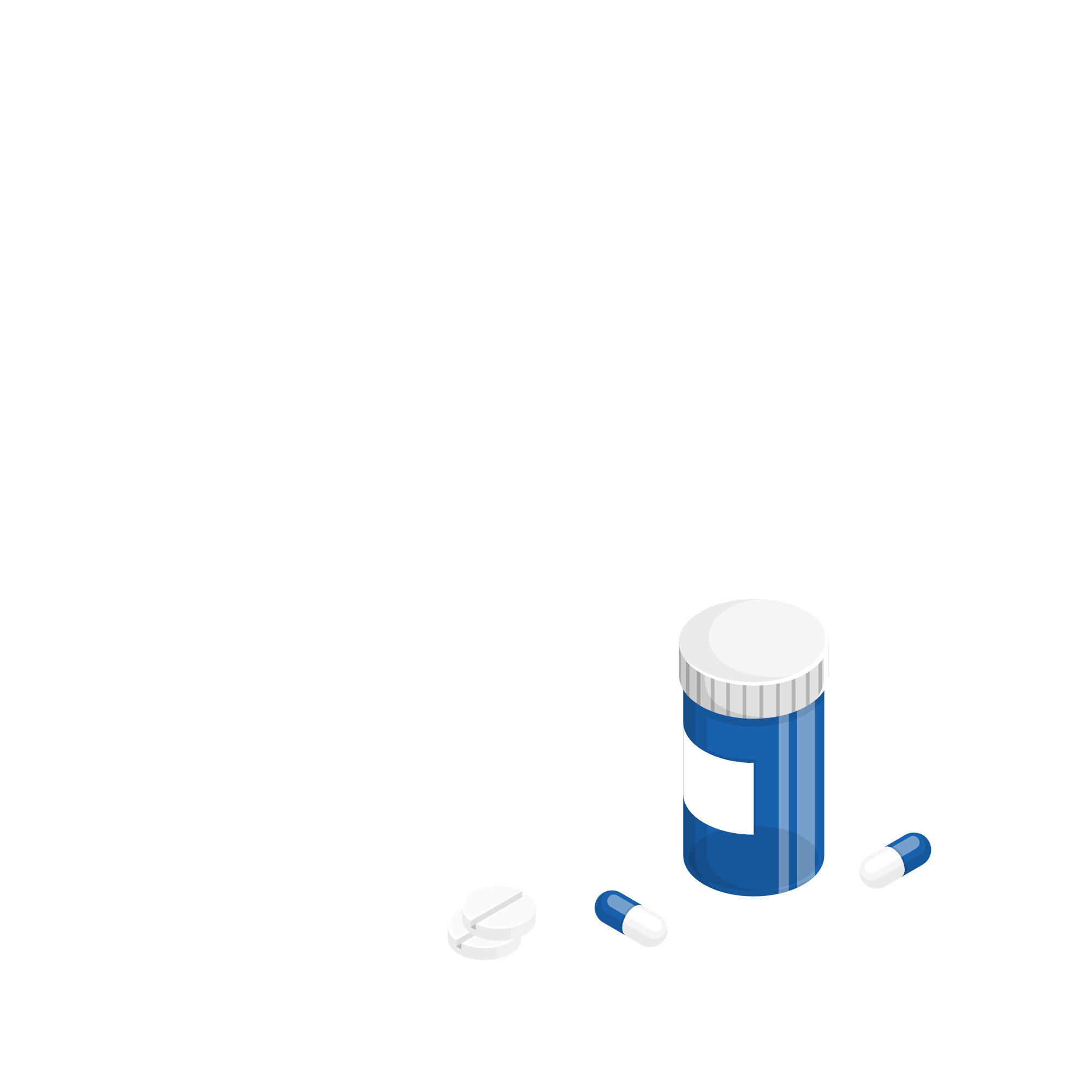
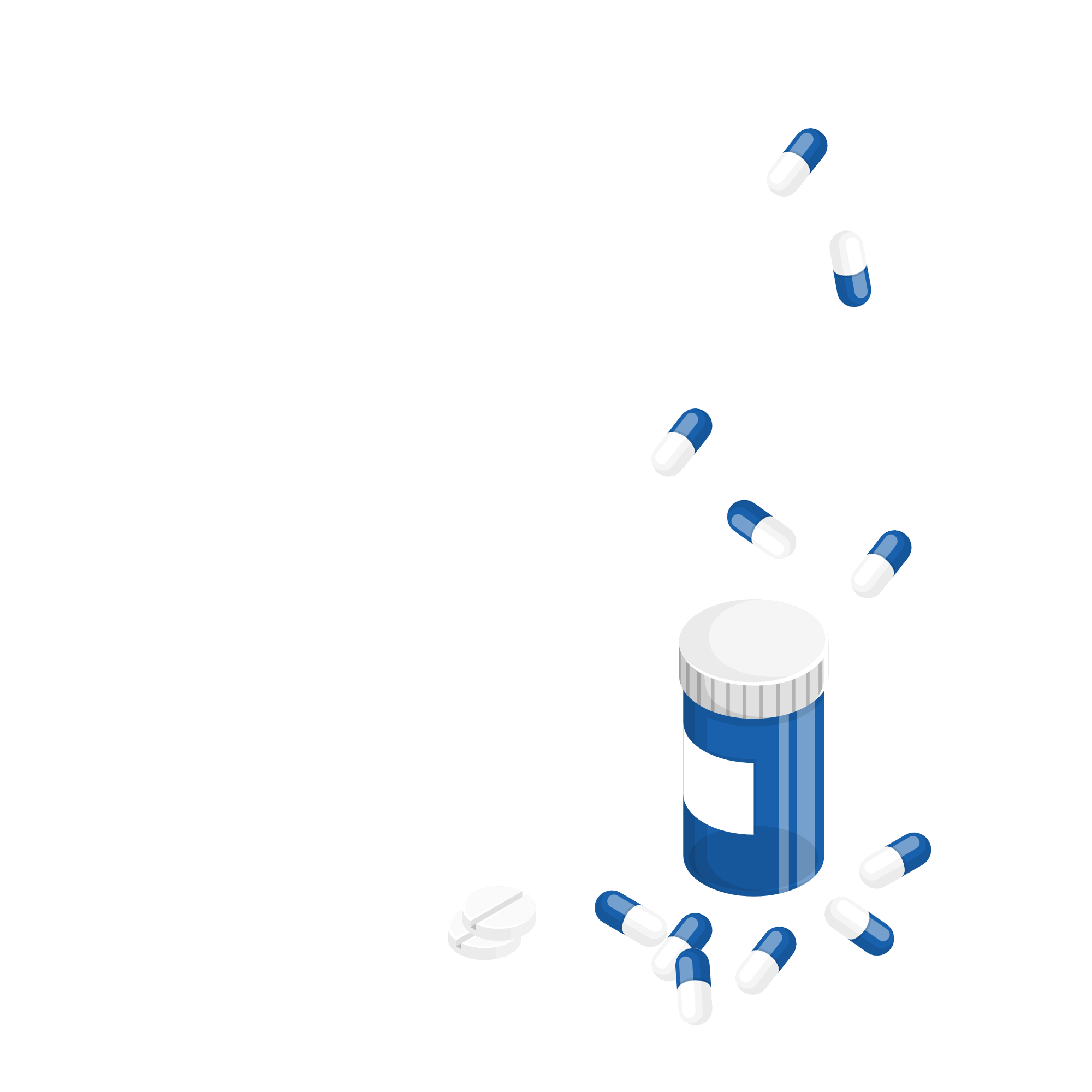
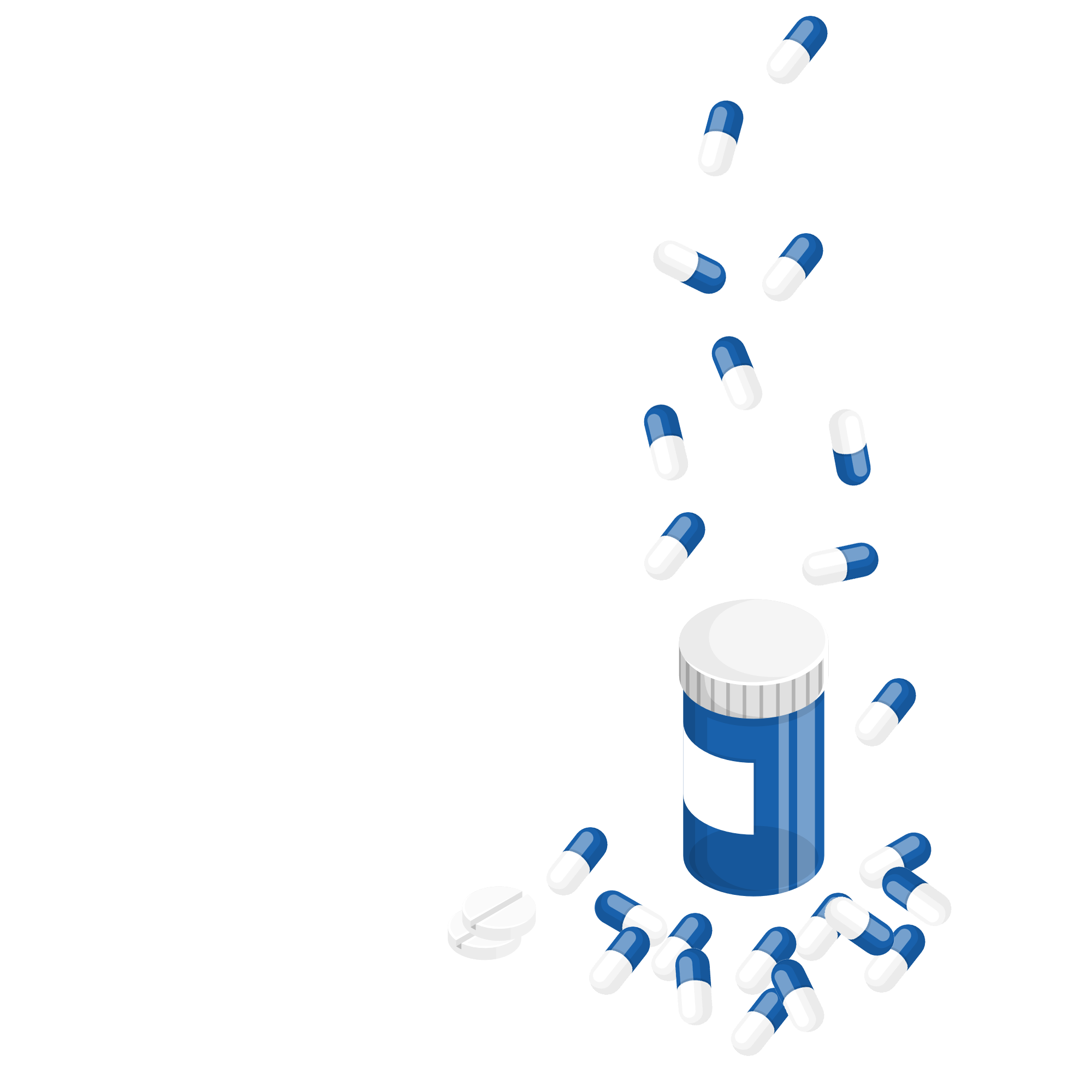
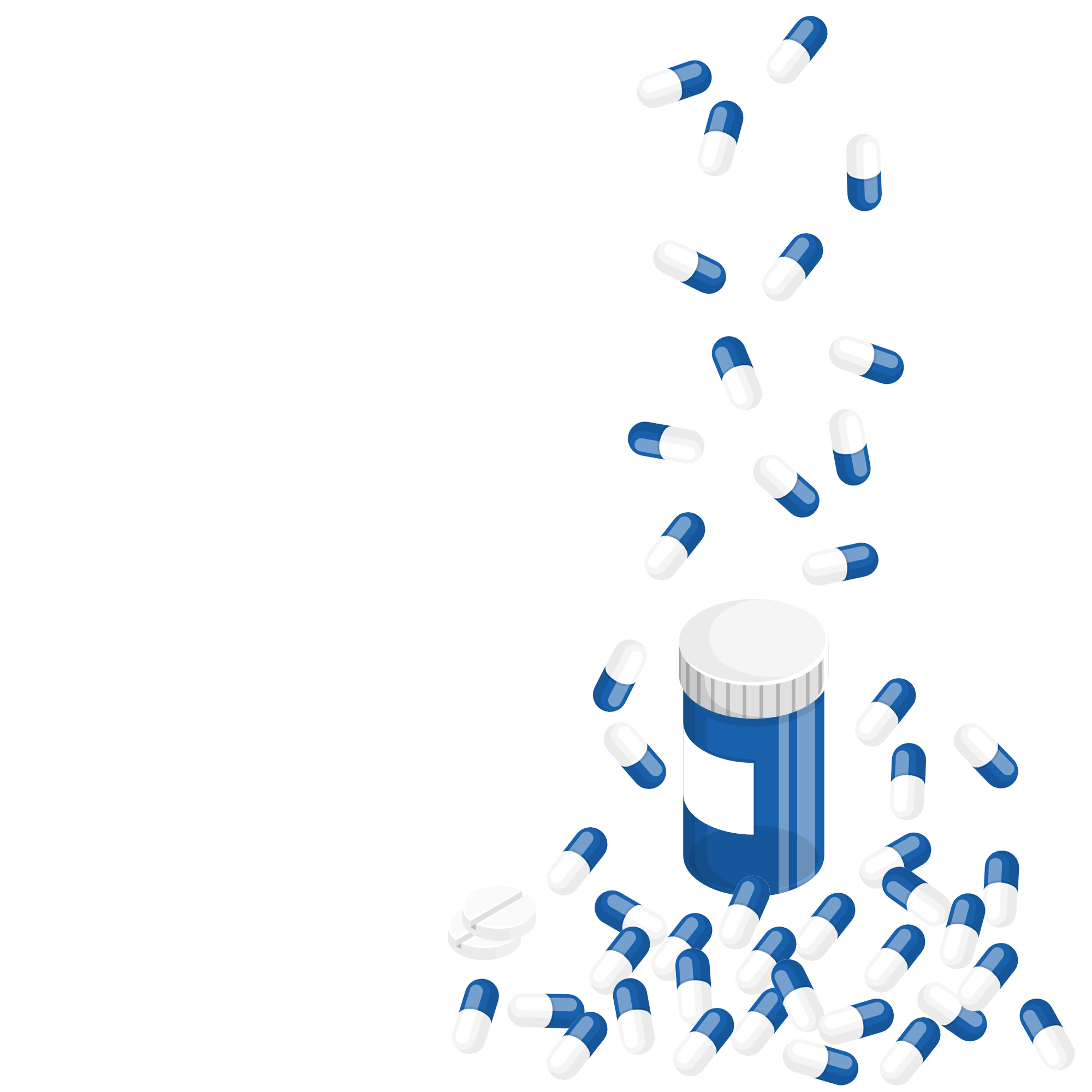
Culture de la prescription
Plus que les chiffres bruts, ce sont les tendances qui préoccupent les experts. «Il existe clairement une surprescription d’opioïdes dans ces chiffres, essentiellement de tramadol, mais l’ampleur du problème est sans comparaison avec les Etats-Unis, où les opiacés forts de classe 3 sont à l’origine de la crise, tempère Bart Morlion, anesthésiste, directeur du Centre de la douleur à l’hôpital universitaire de Louvain et professeur à la KU Leuven. Ces molécules peuvent soulager certaines douleurs sévères, provoquées par des maladies comme le cancer, ainsi que les douleurs aiguës, par exemple après une fracture ou en contexte postopératoire et en soins palliatifs. Elles sont donc très utiles.»
Plusieurs facteurs expliquent cette croissance importante: le vieillissement de la population, la prévalence des maladies chroniques et l’augmentation des cancers. «Le taux de survie après un cancer s’améliore globalement. Or, des études, menées notamment dans notre centre, montrent qu’après une guérison, près de la moitié des patients souffrent de douleurs chroniques. Ils se retrouvent donc dans un mécanisme de douleurs non cancéreuses», poursuit Bart Morlion.
Selon l’Inami, 20% des patients qui ont un usage élevé et chronique d’opioïdes sont âgés de moins de 50 ans.
Mais ce n’est pas tout. Depuis quinze ans, la prescription des opioïdes ne se limite plus aux patients atteints d’un cancer ; les médicaments dérivés de la morphine ont tendance à se généraliser pour soigner d’autres pathologies non cancéreuses comme des maux de dos, de tête, des douleurs articulaires ou des fibromyalgies, par exemple. C’est cette généralisation qui demeure problématique. D’autant qu’à l’heure actuelle, les preuves scientifiques concernant leur valeur ajoutée sur le contrôle de la douleur chronique et sur la fonction physique, en cas de traitement de longue durée (plus de trois mois), sont limitées. Au contraire, de plus en plus de données scientifiques montrent une perte de leur effet antalgique à long terme en raison d’une tolérance. «A leur sortie d’hôpital, les patients reçoivent une prescription de tramadol, puis renouvelée par les médecins généralistes, parfois sous la pression de patients dépendants. Personne ne fait l’évaluation, ne réévalue la douleur», déplore Bart Morlion, qui reçoit régulièrement des patients sous opioïdes depuis des années, dont «la majorité n’en ont pas besoin».
Face à cette augmentation, les autorités sanitaires répondent tant bien que mal. Depuis deux ans, l’Inami a développé un plan d’action. Campagnes, conférences et diffusion de bonnes pratiques à destination des médecins généralistes, premiers prescripteurs d’opioïdes. Les spécialistes de la douleur et les addictologues travaillent ensemble pour remédier à ces dérives et aider les généralistes dans le sevrage de leurs patients. D’autres avancent d’autres pistes pour limiter les risques de dépendance et de surdosage. Ainsi, en janvier 2019, le Service d’évaluation et de contrôle médicaux (SECM), organe opérationnel de l’Inami, a proposé de classer le tramadol parmi les stupéfiants et les psychotropes, afin qu’il soit réglementé par une législation spécifique et plus contraignante. Autre recommandation mise en avant, notamment par les mutualités: restreindre, sur le marché, les grands conditionnements d’opioïdes.
Trois paliers
L’Organisation mondiale de la santé classe les antalgiques par paliers. A l’origine, ces paliers ne concernaient que les patients atteints d’un cancer, ils ont été extrapolés aux autres pathologies.
Palier 1: en vente libre, pour les douleurs légères à modérées. Il s’agit de non-opiacés, comme le paracétamol et les anti-inflammatoires non stéroïdiens (Dafalgan, Ibuprofène, Neurofen…).
Palier 2: délivrés sur ordonnance, pour les douleurs modérées à intenses. Ce sont des opiacés faibles, dérivés «allégés» de l’opium et de la morphine, comme la codéine (Codoliprane) ou le tramadol (Contramal, Ixprim, Zaldiar… Ces deux derniers associent paracetamol et tramadol).
Palier 3: sur ordonnance, pour les douleurs très intenses, voire rebelles. On parle ici d’opiacés forts, la morphine et ses dérivés (Skenan, Fentanyl, OxyContin…).
Surveiller les dérapages tout en soulageant la douleur. Ne pas diaboliser, donc, des produits que la Belgique a longtemps rejetés, laissant souffrir des patients atteints d’un cancer, de douleurs postopératoires. «Les pays de culture protestante, les pays du Nord ont une approche beaucoup plus pragmatique de la souffrance. En Méditerranée, en Espagne et en Italie, on recourt beaucoup moins aux opioïdes, souligne Bart Morlion. En Belgique, l’usage des opioïdes est plus important dans le sud que dans le nord, même s’il augmente en Flandre. Il existe sans doute une différence de la culture de l’ordonnance. Je constate, chez mes patients francophones, que la qualité d’un médecin repose sur la quantité de prescriptions.»
Lui et d’autres experts notent, en tout cas, une évolution positive dans la prise en charge des patients sous opioïdes et, chaque année, une baisse, certes faible, de la consommation. Ils mettent en garde, cependant, sur un report vers les anti- dépresseurs et les somnifères, ces médicaments à base de benzodiazépine exposent les patients à des risques d’addiction. Une autre «crise sanitaire» ; si, en 2021, 10% de la population a reçu une prescription d’opioïdes, en 2022, un Belge sur quatre a consommé des psychotropes.
Texte : Ludivine Ponciau - Soraya Ghali
Enrichissement : Thomas Bernard
Crédit image : People illustrations by Storyset